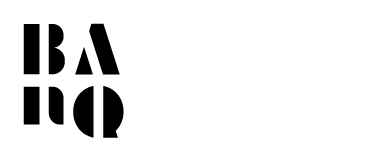
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
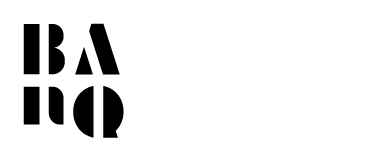
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
La Cour des plaidoyers communs, Greffe de Québec (TP5, S1) et La Cour des plaidoyers communs du district de Québec (TL24), 1765-1777
Présentation
La base de données
La base de données compte 3419 entrées touchant environ 6836 individus. Elle indexe les causes en spécifiant s’il y a un dossier et en donnant une description de la cause. Elle précise également les références aux registres des procès-verbaux d'audiences et de jugements.
La base de données a été bâtie à partir des informations provenant de fichiers produits au palais de justice de Québec. Ces fichiers ont été mis sur microfiches par l’équipe des Archives nationales à Québec (301549). Guy Gagnon a bénévolement et patiemment saisi le contenu dans des fichiers Excel. Le personnel des Archives nationales à Québec a décrit les dossiers qui ont été numérisés quelques années plus tard.
Les fiches avaient été produites en deux exemplaires, ce qui permettait de rechercher tant par le nom du demandeur que par celui du défendeur.
Le territoire desservi
En septembre 1764, le district de Trois-Rivières est aboli et son territoire est divisé entre Québec et Montréal. De fait, le territoire desservi par la Cour des plaidoyers communs, Greffe de Québec, puis par la Cour des plaidoyers communs du district de Québec couvre tout l’est du Québec à partir des rivières Saint-Maurice (rive nord du Saint-Laurent) et Godefroy (rive sud du Saint-Laurent, à Bécancour, en face de Trois-Rivières). On y trouve donc des causes aussi bien de la ville de Québec que de Batiscan, Bécancour, Baie-Saint-Paul, Sainte-Marie-de-Beauce, L’Islet, Kamouraska, Rimouski ou encore de la baie des Chaleurs.
Cette base de données est suivie par l’Index des dossiers de la Cour des plaidoyers communs du district de Québec, Matières civiles en général (TL15, S2), 1777-1794 mis en ligne en 2021.
Conseils pour la recherche
La Cour des plaidoyers communs, Greffe de Québec (TP5, S1)
La Cour des plaidoyers communs est une cour civile de première instance. Le gouverneur James Murray la crée le 7 septembre 1764 pour entendre des causes civiles impliquant des montants excédant 10 livres sterling. Elle doit appliquer l'équité et les droits du pays, pour autant qu'il n'y ait pas de conflit avec le droit anglais.
En pratique, cette cour constitue le tribunal des Canadiens français et s'inspire du droit de la Nouvelle-France pour atténuer les conséquences du changement de régime juridique instauré par la Proclamation royale de 1764. La Cour possède une juridiction sur toute la province et siège initialement à Québec, puis, à partir de février 1765, en alternance avec Montréal.
La Cour des plaidoyers communs du district de Québec (TL24)
En 1770, l'ordonnance 17 Geo. III chap. 1 établit une cour des plaidoyers communs dans les districts de Québec et de Montréal pour entendre toutes les causes civiles de quelque valeur que ce soit. Tenant compte de la restauration du droit canadien par l'Acte de Québec en 1774, cette ordonnance attribue à ces tribunaux, par contraste avec leurs prédécesseurs, l'exclusivité de la juridiction civile de première instance. La Cour du banc du roi est restreinte, par une autre ordonnance de la même année (17 Geo. III chap. 5), à la juridiction criminelle.
La Cour des plaidoyers communs du district de Québec doit siéger au moins un jour dans chaque semaine pour les litiges n'excédant pas 10 livres sterling et un autre jour pour les affaires excédant ce montant. Ce tribunal reçoit aussi la compétence de juger des affaires civiles inférieures ailleurs qu'à son siège principal, pendant des « circuits » ou « tournées » que ses juges doivent accomplir deux fois par an.
Les justiciables peuvent en appeler de ses décisions à la cour d'appel formée par le Gouverneur et son Conseil pour des montants excédant 10 livres sterling ou impliquant des droits futurs.
En 1794, une nouvelle loi sur la judicature abolit la Cour des plaidoyers communs du district de Québec en la remplaçant par la Cour du banc du roi pour le district de Québec qui va cumuler les compétences civile et criminelle.
L’accessibilité des archives
Tous les dossiers et les registres des procès-verbaux d'audiences et de jugements sont entièrement accessibles aux Archives nationales à Québec. Les registres sont disponibles en ligne, de même que la très grande majorité des dossiers.