Sur le plan économique, la ville de Trois-Rivières se développe, au cours du XIXe siècle, en deux temps. La première moitié du siècle se caractérise par un développement plutôt lent, tandis que la seconde fait place à une véritable vague d'industrialisation. Avec l'ouverture de la région mauricienne à l'exploitation forestière, l'activité économique explose et la population, entre 1825 et 1900, passe de 33 000 à plus de 103 000 habitants. Trois-Rivières devient alors le moteur économique de la Mauricie. Les institutions financières s'y installent au même rythme que l'industrie, tandis que le développement urbain et culturel s'adapte au relief accidenté de la ville, ainsi qu'en témoignent la spécialisation progressive de l'espace urbain et l'évolution de son architecture.
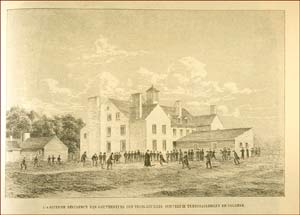
« L'ancienne résidence des gouverneurs de Trois-Rivières, convertie temporairement en collège », gravure tirée de L'Opinion publique, vol. 3, no 29, 18 juillet 1872, p. 341. Photo © Bibliothèque nationale du Québec.
Sous le régime français, la Nouvelle-France compte trois gouvernements : Québec, Trois-Rivières et Montréal. L'illustration précédente montre la résidence des gouverneurs de Trois-Rivières, dont Claude de Ramezay (1659-1724), qui occupe cette fonction de 1690 à 1699, et Charles Lemoyne (1656-1729), qui sera gouverneur en 1720. Détruite dans l'incendie majeur de 1908, qui touche plusieurs bâtiments hérités de l'occupation française, elle est sise à l'emplacement de l'actuel bureau de poste.
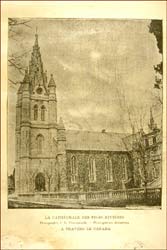
« La cathédrale des Trois-Rivières » photographie tirée du Monde illustré, vol. 7, no 320, 21 juin 1890, p. 113. Photo © Bibliothèque nationale du Québec. Au moment où Belvèze visite Trois-Rivières, la construction de la cathédrale Assomption (1854-1858) vient à peine d'être entamée.