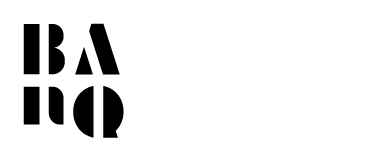
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
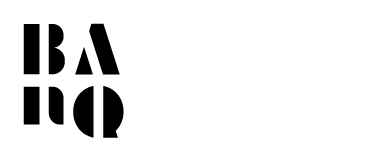
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
Les enfants abandonnés du tour de l’Hôtel-Dieu de Québec, 1800 à 1845
La base de données
La base de données comprend des notices biographiques pour 1388 enfants abandonnés à l’Hôtel-Dieu de Québec entre le 15 novembre 1800 et le 16 avril 1845. Pour chaque enfant, on trouve des informations sur la naissance et le baptême, la date d’admission au tour[1], le placement ou la remise à la mère ou à ses parents, le mariage et le décès.
Classé à titre de bien culturel par le gouvernement du Québec en 2003 parce qu’il jette un éclairage unique sur la dureté des conditions de la vie à Québec dans la première moitié du xixe siècle, le fonds Enfants abandonnés (HDQ-F3), conservé aux Archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, a servi de base à ce projet mené d’une manière exemplaire peu avant 2010 par Claude Kaufholtz-Couture, qui a alors pu compter sur la collaboration de Michel Simard, maintenant employé de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
La reconstitution biographique
La reconstitution biographique a été permise grâce à ces différentes étapes.
Afin de mieux illustrer les notices biographiques, voici un exemple :
[N° 81]
Rose de Lima
Admise au tour le 25 février 1808. Baptisée le 25 février 1808. Placée à Saint-Augustin-de-Desmaures chez la veuve Beaupré entre le 25 février 1808 et le 1er juillet 1818. Détachée de la Commission le 1er mars 1818. Brevet de confiance chez le notaire Antoine Parent, le 15 juillet 1818. D'après le brevet, née le 25 février 1808, confiée et engagée chez la veuve Noël Beaupré [Marie Louise Poitras] de Saint-Augustin. [Rosalie Beaupré (fille majeure de la paroisse de Sainte-Catherine) se marie avec Augustin Careau (journalier, fils majeur de défunt Joseph et Marie Louise Lefebvre) le 31 janvier 1832 à Saint-Augustin-de-Desmaures. Rose de Lima Carreau, femme de Augustin Carreau, décède le 15, inhumée le 16 décembre 1834 à Saint-Augustin-de-Desmaures, âgée d'environ 26 ans].
Le fonds Enfants abandonnés
Le fonds Enfants abandonnés est d’abord constitué de deux registres d’admissions couvrant la période de 1800 à 1845. Ils portent essentiellement sur l’entrée des enfants abandonnés, illégitimes ou légitimes, amenés par des personnes au tour de l’Hôtel-Dieu de Québec dans le but de voir les Augustines les accueillir et les placer dans des foyers nourriciers dans les alentours de la ville de Québec ou bien à Québec même :
Le fonds Enfants abandonnés comprend aussi des registres de pensions qui mentionnent les enfants dans leur foyer nourricier, soit le lieu de leur placement et le nom des personnes chez qui ils résident. À titre administratif, le paiement est indiqué.
Le fonds comprend également des billets retrouvés sur l’enfant lors de son admission. L’information contenue sur ce genre de billet varie beaucoup. Habituellement, on peut indiquer que les parents naturels ne peuvent pas garder l’enfant et qu’après mûre réflexion, il est mieux de le donner. Il peut s’agir aussi d’une note d’un curé qui indique la naissance dans sa paroisse d’un enfant de parents inconnus, en précisant que l’enfant fut baptisé sous tel prénom.
La Commission établie pour l’exécution d’un acte pour le soulagement des personnes dérangées dans leur esprit, et le soutien des enfants abandonnés
Au début du xixe siècle, les Augustines ont accepté de soigner des enfants abandonnés ou trouvés et des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les enfants peuvent être des enfants illégitimes ou encore provenir de veuves ou de veufs incapables de pourvoir à leurs besoins.
Cette œuvre a eu cours dans la ville de Québec entre les années 1800 et 1845. Dès 1801, le Parlement bas-canadien prend la situation en main et crée une Commission accordant des subsides pour venir en aide à ces pauvres enfants abandonnés et placés à l’Hôtel-Dieu de Québec.
Dans son mémoire de maîtrise, Lise Mathieu précise que les enfants étaient déposés à l’hôpital dans un tour muni d’une cloche destinée à avertir la femme de garde. Après avoir été portés au baptême, ils étaient ramenés à l’hôpital et gardés jusqu’à ce qu’on leur eût trouvé une nourrice qui était presque toujours choisie à la campagne. Elle devait être reconnue pour sa bonne conduite et munie d’un certificat du curé de sa paroisse.
La pension des enfants en nourrice était aux frais du gouvernement. Les enfants n’étaient retirés que pour être placés par les commissaires nommés par le gouvernement; un bon nombre de nourrices gardaient ceux qu’elles avaient élevés.
Entre 1801 et 1822, le Trésor subvient aux besoins des enfants à raison de 40 piastres par année par enfant pour une période de 10 ans. Après l’année 1822, le gouvernement diminue l’aide accordée aux enfants à 30 piastres par année sur une période de sept ans.
Claude Kaufholtz-Couture constate que les 1388 enfants se divisent en trois catégories : 744 enfants (54 %) sont décédés en bas âge, 112 (8 %) ont été remis à leurs parents et 532 (38 %) ont été placés en foyer nourricier, pour la plupart dans les campagnes environnantes, dont en particulier à Sainte-Marie-de-Beauce.
Lorsqu’un enfant du tour de l’Hôtel-Dieu de Québec était en âge d’être détaché de la Commission, le foyer nourricier pouvait l’engager afin que le déshérité puisse demeurer dans sa famille d’accueil. C’est alors que le notaire de la Commission rédigeait un contrat intitulé Brevet de confiance et quelquefois aussi Brevet d’engagement.
Dans ce type de contrat, les parents adoptifs, si l’on peut les appeler ainsi, s’engageant à prendre l’enfant avec eux afin de l’élever comme étant le leur. Souvent, le père enseigne au garçon son métier. Pour la fille, elle devient domestique ou bonne à tout faire. Les enfants doivent alors respecter les conditions d’engagement, et ce, jusqu’à l’âge de leur majorité révolue.
La recherche dans les greffes de notaires a permis de trouver seulement 68 brevets de confiance, ce qui représente un peu moins de 12,8 % des enfants placés.
Le 16 avril 1845 arrive le dernier enfant. En 1850, les Augustines placent de façon définitive les derniers enfants qui leur avaient été confiés en 1845.
Sachant que les Augustines ne pouvaient plus s’occuper des enfants abandonnés, les autorités religieuses voulaient intervenir avant la fin des engagements de l’Hôtel-Dieu. C’est pourquoi, en 1848, Mgr Pierre Flavien Turgeon demande aux Sœurs de la Charité de Montréal de poursuivre l’œuvre des Augustines en créant un orphelinat à Québec. C’est en 1849 que mère Marcelle Mallet arrive à Québec pour répondre à l’appel pressant de Mgr Turgeon.
Remerciements
Nous tenons à remercier Claude Kaufholtz-Couture de nous avoir permis de diffuser son travail. Soulignons que le présent texte de présentation s’inspire de son rapport de recherche. Merci également à Michel Simard pour sa contribution à ce projet.
Bibliographie
COUTURE, Béatrice, Enfants abandonnés, enfants accueillis!. Blogue, avril 2025. (Consulté le 7 juillet 2025)
GOUBEAU, Dominique et Claire O’NEIL, « L’adoption, l’Église et l’État », dans Renée Joyal (dir.), L’évolution de la protection de l’enfance au Québec – Entre surveillance et compassion, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 109-142.
KAUFHOLTZ-COUTURE, Claude, Biographies des enfants abandonnés du tour de l‘Hôtel-Dieu de Québec entre 1800 et 1845, Rapport de recherche, 2014, 432 p.
MATHIEU, Lise, Étude de la législation sociale du Bas-Canada, 1760-1840, Thèse présentée pour la maîtrise à l’École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval, le 15 mai 1953.
[1] Le tour, appelé aussi tour d’abandon, est un dispositif permettant de laisser de façon anonyme un bébé pour qu’il soit pris en charge par une institution de bienfaisance, généralement une communauté religieuse. Aujourd’hui, on utilise le terme boîte à bébé.