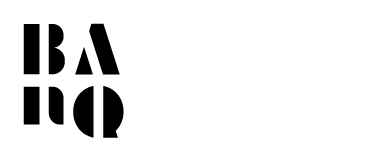
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
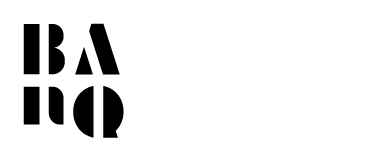
 À propos de BAnQ
À propos de BAnQ
Index des dossiers des cours d’appel siégeant à Québec, 1872-1987 (TP9, S1 et TP15, S1) (dossiers criminels et pénaux)
La base de données
La présente version de la base de données ajoute les années 1985 à 1987. Dorénavant, on y trouve 5 226 dossiers différents produits entre 1876 et 1987 et comprenant 10 450 noms. Rappelons que dans sa version initiale d’octobre 2019, elle comprenait 4 187 dossiers différents produits entre 1876 et 1984 et comportait 9 106 noms.
Les causes portées en appel à Québec ont été entendues en première instance dans les districts judiciaires suivants, dont le numéro est mentionné entre parenthèses :
Abitibi (Amos) (605),
Abitibi (Chibougamau) (170),
Abitibi (La Sarre) (620),
Abitibi (Val-d'Or) (615),
Alma (Alma) (160),
Arthabaska (Victoriaville) (415),
Baie-Comeau (Baie-Comeau), anciennement Hauterive (655),
Beauce (Saint-Joseph-de-Beauce) (350),
Bonaventure (New Carlisle) (105),
Charlevoix (La Malbaie) (240),
Chicoutimi (Saguenay) (150),
Drummond (Drummondville) (405),
Frontenac (Thetford Mines) (235),
Gaspé (Havre-Aubert) (115) (Îles-de-la-Madeleine),
Gaspé (Percé) (110),
Gaspé (Sainte-Anne-des-Monts) (130),
Kamouraska (Rivière-du-Loup) (250),
Mingan (Sept-Îles) (650),
Montmagny (Montmagny) (300),
Pontiac (Campbell's Bay) (555),
Québec (Québec) (200),
Rimouski (Amqui) (120),
Rimouski (Matane) (125),
Rimouski (Mont-Joli) (135),
Roberval (Roberval) (155),
Rouyn-Noranda (Rouyn-Noranda) (600),
Saint-Maurice (La Tuque) (425),
Saint-Maurice (Shawinigan) (410),
Témiscamingue (Ville-Marie) (610),
Trois-Rivières (Nicolet) (400),
Trois-Rivières (Trois-Rivières) (400).
La possibilité de chercher en fonction d’un délit rend cette base de données exceptionnelle. Il est à noter que les appels en matières criminelles et pénales sont rares avant la Première Guerre. Il y a eu seulement une vingtaine de causes entre 1876 et 1914.
La base de données Dossiers des cours d’appel siégeant à Québec (TP9, S1 et TP15, S1) (dossiers criminels et pénaux) a été bâtie à partir des informations provenant des fichiers produits par le palais de justice de Québec. Ces fichiers ont été mis sur microfiches par les Archives nationales du Québec en 2001 (instruments de recherche no 301903 et no 301905).
Ils ont été patiemment saisis dans des fichiers Excel par Hélène Duval, bénévole. Ces données ont été complétées à partir des plumitifs jusqu’en 1984 puis à partir des dossiers mêmes de 1985 à 1987. Cela a permis d’ajouter les références aux dossiers de première instance ainsi que de compléter et de valider les noms et les prénoms. Le recours aux plumitifs a également permis de retrouver les références manquantes sur les microfiches. Dix pour cent des dossiers manquaient parce qu’ils n’avaient pas été indexés ou parce que les fiches avaient été perdues avant leur mise sur microfiche.
De plus, les dossiers de premières instances portés en appel provenant des districts judiciaires dont les archives sont conservées aux Archives nationales à Québec, soit Québec, Charlevoix, Montmagny, Beauce et Frontenac, ont été dépouillés afin de compléter les plumitifs.
Conseils pour la recherche
1. Malgré une vérification avec les plumitifs, des prénoms manquent ou ne comportent que des initiales. Il faut donc être prudent dans sa recherche avant de conclure à l’inexistence d’un dossier.
2. Les données des champs Prénom 1 et Nom 1 et celles des champs Prénom 2 et Nom 2 sont entrées en double avec inversion des informations permettant ainsi d’avoir tous les noms et prénoms dans champs Prénom 1 et Nom 1 et dans les champs Prénom 2 et Nom 2. Cela facilite la recherche.
3. L’application gérant la base de données distingue les caractères accentués et les traits d’union. Il faut donc faire des essais avec les variantes orthographiques.
La conservation des dossiers des cours d’appel siégeant à Québec
Contrairement à ce qui est le cas pour les autres cours, les archives de la Cour d’appel sont conservées intégralement (dossiers, plumitifs, index et registres de jugement). De plus, les dossiers et les jugements en première instance des causes portées en appel sont également préservés. Cela découle de l’adoption de la Loi sur les archives en 1983 et du rapport déposé en 1989 par le Comité interministériel sur les archives.
Une perte importante cependant à signaler : les archives détruites en 1873 dans l’incendie du palais de justice de Québec (voir L’Ancêtre, no 311, été 2015, p. 308-309). Les registres de la Cour du banc du roi en appel manquent pour la période antérieure à 1873, de même que les dossiers s’échelonnant de 1836 à 1872 (TP9).
L’accessibilité des archives des cours d’appel siégeant à Québec
BAnQ conserve aux Archives nationales à Québec les archives des cours d’appel ayant siégé à Québec jusqu’en 1994. Au nom de la transparence de l’administration de la justice, tous ces documents sont entièrement accessibles aux chercheurs.
La richesse des contenus
Chaque cause de la Cour d’appel du Québec et de celles qui l’ont précédée est inscrite sous un nouveau numéro dans le plumitif de la Cour d’appel. Les greffiers concernés transfèrent temporairement le dossier de première instance au greffe de la Cour d’appel, afin de préparer le « dossier conjoint », c’est-à-dire une copie imprimée du contenu du dossier de première instance et la transcription des témoignages, qui sont fournis à tous les juges et parties en appel. L’original est ensuite renvoyé au tribunal de première instance.
Cette présence des factums produits tant par l’intimé (défendeur) que par l’appelant (demandeur) est riche en détails, de fait et de droit. Les témoignages qu’on y trouve fréquemment révèlent le langage parlé des gens de toutes les classes sociales. Le Trésor de la langue française de l’Université Laval s’en est servi pour étudier l’évolution du français avant le développement des enregistrements sonores.
Les archives des cours d’appel sont très utiles pour le développement de la jurisprudence. C’est d’ailleurs pourquoi les publications et revues légales les citent abondamment depuis le milieu du XIXe siècle.
Des appels en matière criminelle étaient très rares au XIXe siècle. À cette époque, ils n’étaient permis que pour corriger une erreur au procès de première instance. Au cours du XXe siècle, le droit d’appel en matière criminelle s’élargit dans des procès par voie de chef d’accusation pour couvrir des questions de droit. À partir de 1961, toute personne condamnée à mort a également un droit d’appel, autant contre sa condamnation qu’à l’égard de la peine fixée par le juge de première instance.
Le contenu des dossiers varie énormément, et ils peuvent être très minces ou fort volumineux. Parfois, il ne s’y trouve que le mandat d’assignation et la déclaration ou la requête du demandeur. Dans d’autres dossiers, il semble que tout le Code criminel ou le Code de procédure civile soit rassemblé : procès-verbaux de signification, dénonciations et plaintes, comparutions, déclarations, interrogatoires hors cours, défenses, répliques, contestations, demandes et avis divers, jugements, mémoires de frais, actes d’exécution, pièces à conviction de toutes sortes, et ainsi de suite.
Si les pièces de procédure offrent des renseignements plutôt d’ordre technique, les pièces à conviction ainsi que les déclarations, les répliques ou les autres plaidoyers peuvent donner de précieux renseignements sur les fondements du litige et sur les affaires familiales ou professionnelles des parties ainsi que sur leurs réseaux sociaux et économiques.
Mentionnons cependant que les transcriptions des témoignages ne se trouvent au dossier que lorsque la cause est portée en appel, contrairement à l’idée générale répandue à ce sujet. La plupart des dossiers de première instance ne contiennent donc pas les transcriptions des témoignages. C’est pourquoi l’historien des familles et le généalogiste ont intérêt à mettre le nez dans les archives des cours d’appel. Elles sont maintenant si faciles d’accès!
Historique des appels
Les appels durant le Régime français
L’unique tribunal de juridiction provinciale (ou coloniale) durant le Régime français est le Conseil souverain (Archives nationales à Québec, TP1), qui jumelle les fonctions d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel; il peut rendre des décisions dans tous les secteurs du droit. Les tribunaux royaux de juridiction locale sont la Prévôté de Québec et les juridictions royales de Montréal et de Trois-Rivières. Ces cours entendent en première instance toutes les causes, tant civiles que criminelles, dans les limites de leur territoire. Elles se consacrent aussi aux appels provenant des cours seigneuriales dans leur territoire.
Les appels durant le Régime anglais jusqu’en 1849
Au début du Régime anglais, le gouvernement de la Grande-Bretagne veut doter sa nouvelle colonie d’une administration de la justice simple et calquée sur les structures anglaises. De 1764 à 1774, le gouverneur et son conseil forment la cour d’appel (TP3). Suivent la Cour d’appel provisoire (1775-1777) (TP7), la Cour d’appel (1777-1793) (TP7), la Cour d’appel provinciale ou Cour supérieure de juridiction civile (1793-1849) (TP7). De la Conquête à 1774, seulement deux dossiers ont été conservés.
La réforme de 1849
Une refonte fondamentale et durable de l’appareil judiciaire a lieu en 1849. Une nouvelle Cour du banc de la reine (TP9) est établie, cette fois de juridiction provinciale et non locale. Elle agit en même temps comme cour d’appel et comme tribunal de juridiction criminelle supérieure. Elle entend des appels tant au civil qu’au criminel. Dans sa juridiction d’appel, ce tribunal siège uniquement à Québec et à Montréal.
À Québec, il entend les causes provenant des tribunaux de première instance siégeant dans le centre et l’est de la province. Durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du siècle suivant, le territoire couvert comprend les districts judiciaires d’Arthabaska, de Trois-Rivières, de Beauce, de Québec, de Montmagny, de Rimouski, de Gaspé, de Saguenay (Charlevoix) et de Chicoutimi.
Quelques années plus tard, en 1864, le gouvernement décide de pallier le fait qu’il n’y a qu’un seul juge par chef-lieu pour la Cour supérieure en instituant une procédure d’appel intermédiaire. Trois juges de la Cour supérieure siègent en révision de la décision d’un seul juge du même tribunal. Cette « cour de révision » permet de contester plus rapidement et à moins de frais que la Cour du banc du roi (en appel). La procédure d’appel intermédiaire sera abolie en 1920.
Aucun changement immédiat dans la structure des tribunaux ne se dessine au moment de la fondation de la Confédération canadienne en 1867, bien que la création de la Cour suprême du Canada en 1875 ajoute ce tribunal canadien à la hiérarchie des appels, l’insérant entre la Cour d’appel du Québec et le Conseil privé à Londres. Ce n’est qu’en 1949 que la Cour suprême du Canada devient celle qui juge en dernier ressort les justiciables canadiens.
En 1974, la Cour du banc de la reine cesse d’exister : elle est remplacée par la Cour d’appel (TP15) quant aux appels et par la Cour supérieure concernant les assises criminelles.